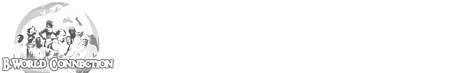DANIEL BOUKMAN, UN HEROS MARTINIQUAIS
 DANIEL BOUKMAN, UN HEROS MARTINIQUAIS
DANIEL BOUKMAN, UN HEROS MARTINIQUAIS
J’ai rencontré l’écrivain martiniquais Daniel Boukman en Algérie, en 1974, lorsque, comme bon nombre de jeunes étudiants antillais de cette époque, j’avais décidé de tout larguer pour rejoindre le rêve de la Révolution algérienne alors dirigée par le président Houari Boumédienne. Avant moi, il avait accueilli, d’une année sur l’autre, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, quelques Haïtiens même.
sources : la rédaction de Montray Kreyol http://www.montraykreyol.org
Une décennie venait de s’écouler après l’indépendance de ce pays (1962) au terme d’une guerre de libération sanglante de huit ans qui avait vu périr un million d’Algériens. Je me souviens de l’arrivée du ferry, à bord duquel j’avais embarqué à Marseille, dans la rade d’Alger la Blanche, et, dans le lointain de cette fin d’après-midi d’octobre, la Casbah et ses demeures mauresques qui surplombaient orgueilleusement la ville européenne. Au contrôle douanier, à la rudesse plutôt des douaniers envers les nombreux immigrés algériens qui rentraient au bled pour de courtes vacances, immigrés qui faute d’argent avait voyagé sur le pont, je compris que quelque chose clochait. Avec moi, les douaniers se montrèrent chaleureux, le souvenir de Frantz Fanon étant encore dans toutes les mémoires. Mes bagages ne furent pas défaits et fouillés comme ceux des autres passagers.
Daniel Boukman m’attendait sur les quais, l’air sombre. Ma venue lui avait été annoncée par un moyen que je ne tiens pas à dévoiler, cela à une époque où n’existait ni mail ni téléphone portable et où les relations téléphoniques entre la France et l’Algérie étaient difficiles.
Lorsque nous nous serrâmes la main, il me lança, flegmatique : « Qu’est-ce que vous venez chercher tous ici ? La révolution est finie. »
Nulle agressivité dans ses propos. Simplement de l’amertume. Sur notre chemin en direction de chez lui, un gamin nous demanda l’heure en arabe dialectal (« Shal es-saa ? »). Je m’étonnai que Boukman ne sut pas lui répondre, à moins qu’il ne fut perdu dans ses pensées. J’avais pour ma part suivi des cours d’arabe à la Faculté des Lettres d’Aix-en-Provence en prévision de mon voyage. Boukman sourit__enfin !__ en me voyant satisfaire la demande du gamin.
Il avait tout préparé : dès le lendemain matin, je partageais, avec un étudiant kabyle dénommé Mahmoud, une chambre à la Cité Universitaire de Ben Aknoun à la périphérie d’Alger et dans la semaine, j’obtenais un job de prof d’anglais pour les cadres d’une société nationalisée s’occupant du transport maritime. Boukman, lui, prenait chaque matin le train pour assurer ses cours de français dans une petite ville appelée Blida. Plusieurs soirs par semaine, il assurait des débats à la Cinémathèque d’Alger, la plus fournie de ce qu’on désignait alors comme le Tiers-Monde.
Pour la première fois, il me fut donné de voir des films bengalis, indonésiens, brésiliens, tchèques, allemands de l’Est, russes etc. Ce qui me frappa d’emblée, c’était le grand respect que lui vouait les spectateurs lorsque, d’une main de maître, il distribuait la parole, faisait des commentaires ou nuançait telle ou telle prise de position. L’homme pénétré, peu disert, qu’il était d’ordinaire, s’enflammait soudain et j’avais quelque mal à croire qu’il ne croyait plus en la révolution algérienne. En tout cas, j’éprouvais une grande fierté à voir un compatriote jouer un tel rôle dans la capitale du pays qui était le phare du Tiers-Monde.
Phare, aimant devrai-je plutôt dire, parce que tout ce qui se proclamait révolutionnaire convergeait vers Alger : Blacks Panthers étasuniens, Corses, Palestiniens, Angolais, Mozambicains, Sud-Africains, Sud-Américains et tant d’autres. Je croisai ainsi Bobby Seale, le Black Panther, ainsi le docteur Abba Siddik, chef du FROLINAT (Front Libération Nationale du Tchad). Une euphorie régnait dans ce petit milieu d’étrangers à qui Boumédienne avait octroyé chacun un local. A la Cité universitaire, des centaines d’étudiants d’Afrique noire côtoyaient des étudiants sud-américains et asiatiques, tous bénéficiant d’une bourse mensuelle de 300 dinars, une fortune dans un pays où le salaire moyen à l’époque ne dépassait pas les 150 dinars. Le Festival Panafricain d’Alger couronnait chaque année cette formidable entreprise de solidarité tiers-mondiste. La Révolution n’était donc pas morte. Sauf que je ne vivais pas dans le pays depuis vingt ans comme Boukman et que je mis du temps à me dessiller les yeux.
Pour ceux qui l’ignoreraient, Boukman a fait partie de ces cinq ou six martiniquais et guadeloupéens (le poète Sony Rupaire et le juriste Roland Thésauros) qui refusèrent de porter l’uniforme français lorsqu’éclata la guerre d’Algérie et qui gagnèrent un camp d’entraînement militaire au Maroc d’où ils furent transbordés clandestinement en Algérie. Ces hommes d’honneur avaient refusé de participer aux massacres, à la torture, à la destruction des mechtas (villages), aux viols dont se rendirent coupables les soldats français parmi lesquels de nombreux Antillais qui aujourd’hui paradent encore, bardés de médailles, toute honte bue, à chaque cérémonie militaire devant les monuments aux morts de nos deux îles. Condamnés à mort pour désertion et haute trahison, Boukman et ses camarades risquaient gros si jamais ils se faisaient prendre. Ils poursuivirent néanmoins dans la voie tracée par Frantz Fanon et pour cela, je les considère, ce mot fut-il galvaudé, comme des héros.
Après l’indépendance, ils furent bien évidemment interdits de séjour sur le territoire français (et donc en Martinique et en Guadeloupe) et demeurèrent en Algérie où chacun trouva un travail. Loin de leurs familles, loin de leur île natale, touchant un salaire plus que modeste, jamais ils ne baissèrent la garde, cela plus de vingt ans durant. Cela ne devrait-il pas nous inciter à faire montre d’un minimum de respect envers ces hommes, même si nous ne partageons pas toutes leurs idées ? Cela ne devrait-il pas interdire à un béké de tourner Boukman en dérision lors d’une émission de télévision récente au motif qu’il a troqué son nom de famille (Blérald) contre un nouveau nom (Boukman) qui est celui d’un des héros de la Révolution anti-esclavagiste à Saint-Dominique à la fin du XVIIIe siècle ? Qu’est-ce que c’est que ce pays où l’on n’a aucune considération pour ceux qui ont voué leur vie entière au service d’une cause noble, celle d’un peuple, l’algérien, qui était en butte à la violence colonialiste permanente ? Sommes-nous tombés si bas dans l’indécence qu’aucune levée de boucliers ne s’est produite suite aux provocations répétées du béké en question ? Pour ma part, j’en ai éprouvé une nouvelle fois de la honte. De la tristesse et de la honte.
Boukman avait, hélas, raison : la Révolution algérienne était en train de se fourvoyer. Deux sociétés prenaient corps : l’une, nantie, francophone, ouverte sur le monde, arrogante ; l’autre, pauvre, arabophone, obligée d’accepter des conditions de vie indécente.
Exemples : la « Révolution agraire » et l’arabisation. La première consistait à redistribuer les grandes plantations abandonnées par les colons et, dans certaines régions, à y arracher la vigne pour y planter du blé. Un matin, au petit jour, à la Cité Universitaire de Ben Aknoun où j’étais logé, nous fûmes réveillés par des hordes de policiers qui sans ménagement se saisirent d’étudiants qu’ils forcèrent à monter dans des bus. Direction la plaine de la Mitidja où la révolution agraire battait son plein. Problème : les rejetons des dirigeants politiques et de la néo-bourgeoisie d’affaire ne faisaient pas partie de ces cohortes de nouveaux paysans. Eux, ils étaient envoyés étudier en toute tranquillité à l’Université Patrice Lumumba (à Moscou), en Allemagne de l’Est, en Roumanie ou en Tchécoslovaquie. C’était aux fils des pauvres de gratter la terre ! Mon ami Mahmoud fut, à son corps défendant, du convoi. Il étudiait le génie mécanique. Ensuite, l’arabisation : déculturée par un siècle de colonisation française, les Algériens ne maîtrisaient plus leur langue ou plus exactement l’arabe écrit, l’arabe littéraire. Il fallait le leur réapprendre et pour ce faire, des centaines d’enseignants égyptiens, syriens et jordaniens avaient été recrutés. Dans les entreprises, les employés étaient libérés une heure avant la fermeture pour suivre des cours d’arabe au sein même desdites entreprises. Dans celle où j’enseignais l’anglais, mon collègue, Syrien, faisait grise mine : alors que ma salle de classe était remplie, la sienne était toujours aux trois-quarts vides. Les employées femmes, surtout les secrétaires, me confia-t-il amèrement, invoquaient leurs règles, cela deux ou trois fois par mois, pour ne pas assister à ses cours d’arabe classique. C’est que le peuple avait compris : l’arabisation était réservée aux dénantis et le français aux nantis. D’ailleurs, à l’Université, les premiers diplômés arabophones savaient qu’ils ne trouveraient nulle part du travail puisque l’administration algérienne fonctionnait encore totalement en français. Situation qui perdure encore largement aujourd’hui près d’un demi-siècle après l’indépendance.
Boukman savait tout cela bien mieux que moi. Lui qui avait été partie prenante de la révolution algérienne voyait avec amertume celle-ci prendre un cours néfaste, mais pour autant, il ne reniait rien de sa décision de l’avoir accompagnée. Il ne reniait aucunement ce pays et ce peuple qui l’avaient accueilli. Dans la vie quotidienne, il se mouvait comme un poisson dans l’eau parmi les Algériens. Souvent, il m’interrogeait sur sa Martinique qu’il n’avait pas vue depuis vingt et quelques années et que sans doute il ne reverrait plus jamais (c’est l’élection-surprise de François Mitterand à la tête de l’Etat français qui, en 1981, amnistia les « déserteurs » de toutes les guerres et permis à Boukman et à ses camarades de revenir au pays natal). Il voulait comprendre. Il était sévère avec Césaire, mais sans plus. Il avait été le premier à avoir osé le critiquer dans une pièce de théâtre. Je n’avais que peu de réponses à lui fournir. Je croyais avoir tourné le dos à la Martinique et voulais devenir algérien. Comme Fanon.
Boukman menait donc une vie de militant, d’animateur cinématographique, d’enseignant, de dramaturge surtout, toutes choses auxquelles il se vouait corps et âme. S’il l’avait voulu, il aurait facilement pu, à l’instar de nombre de révolutionnaires étrangers, intégrer la nomenklatura algérienne, devenir un cadre du régime et mener une vie aisée. Il s’est refusé tout net à ce qu’il considérait comme une trahison des idéaux qui l’avait conduit dans ce pays et me mit en garde contre semblable tentation. Quatre événements fortuits m’en dissuadèrent : un jour, dans un bus bondé dans lequel je me trouvais, sur la route d’El-Harrach, un passager vêtu d’un turban et d’un burnous, lança un ordre d’une voix qui ne souffrait aucune contradiction au chauffeur lequel se gara immédiatement sur le bas-côté. L’homme au turban descendit alors sans se presser, déroula un tapis de prière par terre et se mit à prier durant vingt bonnes minutes sans qu’aucun des passagers terrifiés ne pipe mot. « C’est un frérot », me souffla mon voisin de siège. Autrement dit un Frère musulman ; une autre fois, sur le grand boulevard Larbi Ben M’Hidi, je vis un homme en train de tabasser une jeune femme. Les passants assistaient à la scène sans bouger, certains insultant même la victime. Je compris qu’elle portait une tenue jugée indécente (une jupe qui lui arrivait juste aux genoux !). La police finit par arriver, posa quelques questions et embarqua…la femme ; à l’entrée de la Casbah, où j’aimais à me promener, je reçus une violente gifle qui fit tomber la cigarette que j’avais à la bouche. J’avais simplement oublié qu’on était en plein mois du Ramadan et que j’avais une tête d’Algérien. Seuls les étrangers étaient autorisés à fumer et à manger ; enfin, à nouveau dans un bus où je fus le dernier à descendre au terminus, le chauffeur me lança une phrase que je ne compris pas. Une phrase en kabyle, la langue des premiers habitants de l’Algérie, les Berbères. Mon colocataire Mahmoud me la traduisit en rigolant : « Ces sales Arabes nous font chier ! ». Les passagers s’étaient, en effet, montrés un peu bruyants. J’ignorais jusque-là que je pouvais avoir une tête de Kabyle.
Bref, déjà en 1974-75, on pouvait deviner les prémisses de ce que deviendrait l’Algérie par la suite : développement du fondamentalisme musulman, continuation de la domination masculine, hostilité du pouvoir envers la revendication kabyle, installation d’une bourgeoisie hypocrite pro-nationale en parole et inféodée aux intérêts étrangers dans les faits etc…Daniel Boukman avait depuis longtemps établi le diagnostic et nos longues conversations me permirent de mieux en saisir les tenants et les aboutissants. Autant il était déçu par le cours que prenait la révolution, autant il avait une énorme confiance dans le peuple algérien et dans sa capacité de résistance. Mais ce n’était plus son combat. Son combat était désormais celui du peuple martiniquais.
Il regagna donc la France où, des années durant, il s’employa avec d’autres à organiser l’émigration antillaise, mettant même sur pied une radio-libre, Radio-Mango. Puis, il fit le grand saut vers le pays natal. Du pays rêvé, pour reprendre l’expression d’Edouard Glissant, il revenait au pays réel. Je suppose que cela a dû avoir été un choc pour lui. Nous n’en avons jamais parlé. Toujours est-il qu’il se prit de passion pour la langue créole, désertant (sans jeu de mot) le français dans ses œuvres littéraires et devenant l’un des meilleurs écrivains créolophones de la Martinique. Sans s’inféoder à aucun parti, il se mit à militer avec les « patriotes » et les écologistes, vivant d’émissions de radio et de cours dans des instituts de formation. Vivant à nouveau très modestement comme en Algérie. Non reconnu à sa juste valeur, ignoré même par certains qui feraient mieux de se regarder dans la glace le matin pour contempler leur tête de faux-jetons et de pseudo-nationalistes. J’invite depuis longtemps Boukman a écrire un roman sur l’épopée des Antillais qui refusèrent de participer à la guerre d’Algérie. Il me répond à chaque fois : « Je ne suis pas romancier, mais poète et dramaturge. Fais-le, toi ! ».
Je le ferai un jour ! En l’honneur de ce héros martiniquais qu’est Daniel Boukman…