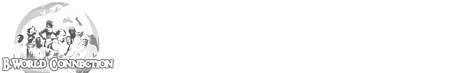ARCHIVES - GUADELOUPE: Quatre siècles d'incompréhensions
 GUADELOUPE: Quatre siècles d'incompréhensions
GUADELOUPE: Quatre siècles d'incompréhensions
Colons", "esclavage", "économie de comptoir"... Ces expressions, qui semblent surgies d'un passé lointain, reviennent sans cesse dans les discours des différents acteurs du conflit qui paralyse depuis plusieurs semaines la Guadeloupe, et a progressivement gagné la Martinique. Vu de métropole, leur emploi ne peut que surprendre. Car enfin, les DOM sont des départements - presque - comme les autres, leurs habitants sont des Français à part entière et la solidarité nationale joue à plein...
Un manifestant, le 17 février, à Fort-de-France.
Les Antilles s'embrasent, et semblent une fois de plus hantées par leur passé. Ce fait surprend d'autant plus que leur histoire est très mal connue en métropole. Or, pour bien comprendre ce qui se joue actuellement en Guadeloupe, il importe de remonter longtemps en arrière. Car les anciennes colonies des Antilles françaises ont un héritage particulier, qui pèse lourdement sur leur physionomie actuelle. Et leurs relations avec la France "continentale" n'ont jamais été simples.
C'est en 1635 que les premiers colons français s'installent en Guadeloupe et en Martinique. La culture de la canne à sucre, très lucrative, s'y développe rapidement. Comme celle-ci nécessite une main d'oeuvre abondante, les planteurs ont bientôt recours à l'achat d'esclaves venus d'Afrique noire. Les sociétés esclavagistes se mettent en place : on estime que quatre millions de personnes ont connu l'esclavage dans les colonies françaises (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Domingue...). Deux millions d'esclaves naîtront dans les colonies. Les autres seront victimes de la traite atlantique.
Les relations commerciales avec la métropole sont alors régies par le système dit de "l'exclusif" : théoriquement, les navires français ont le monopole du commerce avec les colonies. Ce système sans cesse contourné, qui scandalise les colons, n'empêche pas la constitution sur place d'importantes fortunes, bâties sur l'exploitation des plantations. Mais il constitue aussi une inestimable rente de situation pour les marins et les ports français, qui en tirent de copieux bénéfices. Et contribue à installer les colonies dans une dépendance vis-à-vis de la métropole, dont elles ne sont jamais réellement sorties.
Les sociétés esclavagistes sont des organisations particulièrement instables. Les planteurs européens, en grande infériorité numérique (à la fin du XVIIIe siècle, on compte en moyenne 112 esclaves par plantation en Guadeloupe et en Martinique), vivent dans la hantise permanente d'un soulèvement, et font donc régner une discipline de fer. Un Code Noir, censé réglementer l'oppression, est édicté en 1685 sous l'égide de Colbert. Il ne sera jamais appliqué. Dans les plantations, les esclaves sont soumis à l'arbitraire.
La peur est permanente, du côté des esclaves comme de celui des maîtres. Ceux-ci craignent plus que tout la classe émergente des "libres de couleur", ces métis ou affranchis, souvent propriétaires d'esclaves, qui réclament l'égalité des droits et sont soupçonnés de visées abolitionnistes. Au XVIIIe siècle, les colonies verront l'affirmation du "préjugé de couleur", justification idéologique d'une hiérarchie sociale fondée sur la couleur de peau appelée à une sombre postérité.
La Révolution française arrive en plein apogée des colonies esclavagistes. Elle aura une influence décisive sur leur destin : malgré les efforts d'un puissant lobby, le Club de Massiac, la cause abolitionniste, défendue entre autres par la Société des amis des Noirs, progresse. Dans l'élan de 1789, la révolution de Saint-Domingue, menée par Toussaint Louverture, éclate en 1791. Le 16 pluviôse an II (4 février 1794), la Convention décrète l'abolition de l'esclavage.
Cette décision ne sera effective qu'en Guadeloupe et à Saint-Domingue. En effet, les colons de Martinique ont choisi de se rallier à la Couronne britannique plutôt que d'abolir l'esclavage. Ils restent ainsi à l'abri des convulsions révolutionnaires, alors qu'en Guadeloupe, Victor Hugues, commissaire de la République, fait exécuter nombre de contre-révolutionnaires, décimant la classe des propriétaires.
Napoléon Bonaparte décide de rétablir l'esclavage, en 1802. Ce choix catastrophique mènera à la perte de Saint-Domingue (devenue république d'Haïti, le 1er janvier 1804) et à une répression sanglante en Guadeloupe. A l'aube du XIXe siècle, la Martinique reste relativement prospère, tandis que la Guadeloupe est exsangue. Une bonne partie des structures de production guadeloupéennes passeront aux mains de "békés" Martiniquais. Sans doute ce bouleversement régional explique-t-il pour beaucoup les tensions et les différences sociales qu'on peut observer aujourd'hui encore entre les deux îles.
La première moitié du XIXe siècle sera principalement marquée par le combat pour l'abolition. Malgré les protestations des planteurs, celle-ci est devenue inéluctable. Le 27 avril 1848, la IIe République met fin, définitivement cette fois-ci, à l'esclavage. Mais, par peur des troubles (le souvenir de l'insurrection de Saint-Domingue est encore vif), Paris fait le choix - économiquement désastreux - d'en perpétuer les fondations : maintien d'un régime proche de l'exclusif, choix réaffirmé de la monoculture sucrière. Il ne faut surtout pas que les Antilles soient autosuffisantes.
Sur place, il s'agit d'encadrer strictement la liberté nouvelle des anciens esclaves, souvent remplacés par des travailleurs "contractuels", venus d'Inde ou d'Afrique, travaillant pour des salaires de misère dans des conditions proches de la servitude.
Certes, les anciens esclaves obtiennent le droit de vote, en même temps que la liberté. Mais les taux de participation aux élections s'effondrent rapidement, passant de 70 % à 11 % entre 1848 et 1871, et l'instruction publique reste longtemps indigente. A la fin du XIXe siècle, le taux de scolarisation des enfants de 6 à 10 ans est de 14 %. "Une main-d'oeuvre peu coûteuse, disciplinée, très encadrée, aux droits civiques limités, peu scolarisée, économe et consommatrice : tel fut le modèle idéal du nouveau citoyen colonial", résume l'historienne Nelly Schmidt, auteur d'un récent essai sur la politique coloniale de la France aux Antilles, La France a-t-elle aboli l'esclavage ? (Perrin, 364 p., 22 euros).
Tandis que les Antilles, jadis florissantes, s'enfoncent dans le sous-développement, les populations locales sont incitées à oublier les horreurs du passé, à travers les appels à la réconciliation et le culte de Victor Schoelcher (1804-1893), artisan de l'abolition. Privée d'expression publique, la mémoire de l'esclavage se perpétue souterrainement. Sans doute est-ce pour cela qu'elle resurgit violemment à partir du milieu du XXe siècle. Et plus précisément après 1946, date capitale dans l'histoire des Antilles françaises, qui accèdent cette année-là au rang de départements.
Vieille revendication d'une gauche fidèle à l'idéal "assimilationniste", la départementalisation apparaît alors comme le geste généreux d'une France émancipatrice désireuse de transformer les petits-fils d'esclaves en citoyens français. Mais l'"assimilation" politique ne s'accompagne pas d'une véritable émancipation économique et sociale. Economiquement, les Antilles françaises sont maintenues dans une dépendance totale vis-à-vis de la métropole. Quant aux structures sociales, elles ne sont pas fondamentalement remises en cause.
Au fil des années, l'idée que la départementalisation est un "échec" gagne du terrain aux Antilles. Significative est, de ce point de vue, l'évolution d'un Aimé Césaire (1913-2008). Invité par Le Monde, en mai 1971, à dresser le bilan de la loi de 1946, dont il avait été le rapporteur devant l'Assemblée nationale, le député et maire de Fort-de-France ne cache pas son amertume : "En 1946, nous avons rêvé d'une France généreuse (...). La départementalisation, pour nous, devait être l'égalité des droits. Elle ne le fut pas. Le nouveau système est devenu encore plus colonialiste que l'ancien. Peu à peu, il a secrété ses privilégiés : ceux qui vivent de lui, les fonctionnaires, les grosses sociétés, le "lobby" antillais qui pèse sur le pouvoir."
Si le poète martiniquais, ancien partisan de l'"intégration", en vient à se faire le chantre de l'"autonomie", d'autres iront jusqu'à réclamer l'indépendance. Apparue dans l'entre-deux-guerres, la nébuleuse indépendantiste ne se constitue toutefois en force structurée que dans les années 1960. A l'instar du GONG (Groupement des organisations nationalistes guadeloupéennes), dont la fondation en 1963 s'inscrit dans un contexte régional porteur : arrivée au pouvoir de Fidel Castro à Cuba en 1959, publication par le psychiatre martiniquais Frantz Fanon des Damnés de la terre, devenu dès sa sortie en 1961 l'un des principaux bréviaires de la pensée anticolonialiste ; émancipation des Antilles britanniques, dès 1962 pour la Jamaïque et Trinité-et-Tobago.
Politiquement instables, économiquement fragilisées par l'inexorable déclin de la canne à sucre, touchées par un chômage endémique, les Antilles françaises semblent incapables de digérer quatre siècles de malentendus avec la métropole. Quitte à rejouer, à intervalles réguliers, le même scénario tragique : 14 février 1952, trois mois de grève dans le secteur sucrier, répression par les CRS, 4 morts et 14 blessés au Moule ; 26 mai 1967, grève dans le bâtiment, émeutes à Pointe-à-Pitre, intervention de la police, officiellement 7 morts (on parle aujourd'hui de 87 victimes) ; 24 mars 1971, violentes échauffourées à Basse-Terre, après trois mois de grève générale... "La France généreuse n'a fait que panser les blessures causées par un système qu'elle a laissé survivre", notait à l'époque l'envoyé spécial du Monde, Noël-Jean Bergeroux. Trente-huit ans plus tard, l'analyse semble encore étrangement pertinente.